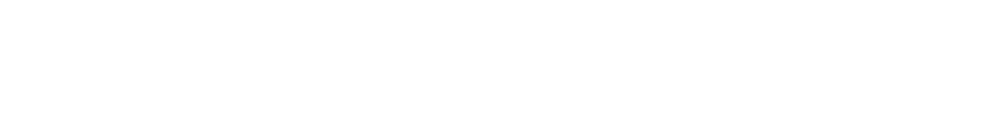Conférence de Jonathan Bel Legroux au CFA OMNISPORTS
Pour une “première” officiellement annoncée comme telle, la salle était bien remplie : une vingtaine de participants, surtout des entraîneurs, curieux de comprendre comment la préparation mentale — et l’hypnose en particulier — peuvent s’intégrer, simplement et efficacement, au quotidien de l’entraînement. Pendant une heure, nous avons alterné apports concrets, mises en situation et questions-réponses, avec une boussole claire : repartir avec des idées immédiatement utiles, plus que des grands principes.
Un parcours de terrain qui mène… au mental
L’intervenant a d’abord posé le décor : éducateur sportif et prof d’EPS de formation, passé par le rugby et l’escalade, il s’est tourné vers l’hypnose après plusieurs accidents qui l’ont éloigné d’une carrière de haute montagne. L’hypnose l’accompagnait déjà en filigrane — une tante anesthésiste l’utilisant en bloc opératoire — ce qui a nourri une vision très “classique” et non spectaculaire de la pratique. À Grenoble, au cœur d’un milieu sportif et alpin, les sollicitations se sont multipliées : gestion des appréhensions après chute, reprise de confiance au ski, etc. De fil en aiguille, l’hypnose est entrée sur le terrain du haut niveau (JO 2012, Rio, Paris 2024) puis s’est élargie à la préparation mentale.
Préparation mentale : au-delà des slogans
Invités à proposer leurs définitions, les participants ont cité motivation, concentration, gestion du stress, visualisation… Autant de thèmes justes, mais partiels. La définition de référence rappelée en séance : un ensemble d’habiletés cognitives et stratégiques visant la performance le jour J, tout en favorisant plaisir… et autonomie. Nous avons nuancé ces deux derniers mots. Dans le sport de haut niveau, l’autonomie a des limites très concrètes (logistique, parcours de soins, entourage). Quant au “plaisir”, il n’est pas quotidien : la rééducation est fastidieuse, les étirements peu “motivant” pour bien des athlètes. D’où l’idée centrale de la conférence : le mental n’est pas “le dernier étage” à travailler après tout le reste. Il conditionne la manière d’entrer dans la séance, de percevoir la charge, d’interpréter un tirage au sort… Le mental est au début, pas à la fin.
Premier préparateur mental : l’entraîneur
Message fort : l’entraîneur est, de fait, le premier préparateur mental. Son regard, sa posture, son langage non verbal modulent instantanément l’état interne d’un athlète. Or, on demande souvent “Concentre-toi” sans jamais fournir le “manuel” de la concentration. La conférence a donc insisté sur la communication comme premier outil : mots, rythme, tonalité… et surtout formulation. Dire “Pas de stress” active… le tiroir “stress”. Mieux vaut orienter vers ce qu’on veut voir se produire (respirer, installer sa saisie, engager la première intention) plutôt que lutter contre ce qu’on ne veut pas.
Deux démonstrations : quand l’imaginaire change le réel
Nous avons proposé deux mises en situation, simples et reproductibles par tous, pour illustrer l’axe corps–esprit.
- La rotation du buste : bras tendu, pivot jusqu’à une butée, marque visuelle, retour. Puis répétition uniquement en imagination, au-delà du point bloquant, avant de refaire le mouvement réel. La plupart des participants gagnent instantanément de l’amplitude. Message pédagogique : l’imagerie prépare des adaptations corporelles. Montrer ça à un groupe suffit souvent à légitimer un travail mental.
- La vision périphérique : regard fixe, attention élargie à gauche/droite/haut/bas. La majorité a constaté un ralentissement du flux des pensées. On peut alors proposer une suggestion (“le corps est attiré vers l’arrière… puis vers l’avant”), pour ressentir comment une idée se transforme en acte. Cette induction, praticable yeux ouverts au bord d’un terrain, est un levier pour réduire la ruminination, retrouver de la disponibilité et faire passer des consignes clés.
Mais au fait, l’hypnose, c’est quoi ?
Ni sommeil, ni inconscience. C’est un état naturel, vécu par tous (les “creux ultradiens” où l’attention décroche, le “flow” en sport, la distorsion du temps, la focalisation extrême sur la voix de l’arbitre…). L’intérêt ? Dans cet état, certaines fonctions involontaires (émotions, douleur, pensées automatiques, physiologie) deviennent plus malléables. On ne “force” pas la volonté ; on parle au bon niveau du système. De là, trois terrains d’intervention très opérationnels :
- La pensée : si ~85 % des pensées d’hier reviennent aujourd’hui, un dialogue interne négatif s’auto-entretient. Les suggestions et la vision périphérique offrent des fenêtres de “silence mental” où l’on choisit une pensée utile qui infuse vraiment l’action.
- L’émotion : distinguer stress (mécanisme adaptatif) et peur (émotion protectrice). On n’éteint pas le stress, on l’apprivoise ; on désactive, si besoin, une peur “apprise” qui s’est généralisée (ex. appréhension après une chute). Traité tôt, un inconfort ne devient pas blocage.
- La physiologie : récupération, sommeil, activation. En réathlétisation, l’imagerie précise et contextualisée limite la fonte, entretient la coordination et prépare les retours.
Croyances : fissurer le plafond de verre
Autre point-clé : les croyances de performance (“les autres peuvent, pas moi”, “je suis trop petit”, “le haut niveau n’est pas pour moi”) filtrent l’expérience. Le sport regorge d’exemples où une barrière “impossible” tombe, puis le peloton suit (mile sous 4’). Le travail consiste à documenter l’exception (qui, de même taille ou profil, l’a fait ?), remonter à l’origine de la croyance (épisode anodin… mais marquant), puis la reprogrammer via imagerie, langage et expériences correctrices. Une athlète de vitesse en escalade citée en exemple a franchi un cap dès le lendemain d’un travail centré sur la croyance — non par magie, mais parce que la physiologie prête a enfin rencontré un “oui” mental crédible.
Des questions très terrain
- “Peut-on tout faire soi-même ?” Oui pour des routines d’auto-hypnose simples (vision périphérique + intention claire). Évidemment pas au volant, ni dans des contextes exigeant une vigilance externe.
- “Et en entreprise (vente, prise de parole) ?” Même logique : il y a une performance à l’instant T. On transpose les mêmes outils : préparation d’état, scénarisation mentale de la séquence, ajustement des croyances.
- “Jusqu’où visualiser sans mentir au corps ?” On vise le réaliste ambitieux. Imaginer 150 kg au développé couché sans base n’a pas de sens ; en revanche, respecter la chronométrie mentale et se voir réussir la prochaine marche accélère l’apprentissage.
- “Et si la suggestion ne marche pas tout de suite ?” Le contexte compte : sécurité (un dossier de chaise derrière soi !), direction plus “naturelle” selon l’activité (ex. les judokas partent plus facilement vers l’avant que vers l’arrière), et surtout temps individuel. En tête-à-tête de 5 minutes, la sensibilité augmente nettement.
Ce qu’un staff peut mettre en place dès demain
- Soigner le langage : bannir “pas de stress” au profit de consignes orientées action.
- Installer des micro-routines “yeux ouverts” : 30–60 s de vision périphérique avant un consigne clé, au vestiaire ou au bord du terrain.
- Tester–prouver : la démonstration de la rotation du buste pour crédibiliser l’imagerie.
- Capter l’émotion tôt : après une frayeur, traiter immédiatement l’appréhension (respiration guidée, ancrage, imagerie de maîtrise) pour éviter la généralisation.
- Interroger les croyances : “Qu’est-ce qui te fait penser que… ? Qui, à ton profil, l’a déjà fait ?” Puis scénariser la première preuve à fabriquer.
- Rappeler le cadre : la préparation mentale n’est pas la psychothérapie. Dès que l’état plonge sous la “ligne de flottaison” (déprime, souffrance envahissante), on oriente vers le médical/psy.
En guise de conclusion
La conférence a voulu démystifier et outiller. Le mental n’est ni un supplément d’âme ni une boîte à tours. C’est un champ d’apprentissage — au même titre que le physique, la technique, la tactique — avec ses méthodes, ses contraintes (temps, espace, urgence), et surtout ses effets concrets quand on le travaille en amont. L’entraîneur est au cœur du jeu : par sa manière de regarder, de parler, de structurer l’attention, il peut déjà transformer l’expérience de l’athlète. Et quand l’état interne est le bon, une bonne suggestion devient un bon geste.
Pour prolonger : nous proposons des contenus réguliers et des sessions thématiques pour découvrir, étape par étape, ces outils et leur mise en œuvre dans des situations réelles. Objectif : rendre la préparation mentale accessible, praticable, et utile… tout de suite.