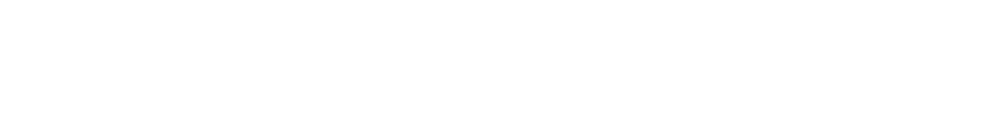Courir un ultra-trail de 160 km, c’est plonger dans une certitude : celle de rencontrer la fatigue, la chaleur, le froid, le manque de sommeil et, souvent, la souffrance. Pourtant, souffrir n’est pas une fatalité. La préparation mentale permet de dissocier la douleur, inévitable, de la souffrance.
« La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. » – proverbe bouddhiste
Dans cet article, je partage comment j’ai pu courir un ultra de 160 km sans souffrance.
La distinction entre douleur et souffrance
La douleur physique fait partie intégrante de l’effort d’endurance. Après tout, ce sont des épreuves qui consistent à « endurer », du latin indurare : devenir dur, résistant. Elle se manifeste par la fatigue musculaire, les articulations qui tirent ou encore la faim qui tenaille. On la voit comme un ennemi contre lequel il faut lutter. Pourtant, si l’on change de perspective, on peut la voir comme cet ami bienveillant. À la différence d’un ami complaisant qui nous dit ce que nous voulons entendre, la douleur pourrait être la définition même de la bienveillance : gênante, inconfortable et même insupportable par moments, elle est là pour nous, pour notre santé, notre survie, sans se soucier d’être aimée ou détestée. Elle n’essaie pas de nous séduire mais nous transmet des messages essentiels, comme ces amis qui savent prendre le risque de nous blesser mais qui nous font avancer.
La souffrance, elle, naît de l’interprétation mentale de cette douleur. On a pour habitude de dire : « La souffrance, c’est l’ego qui a mal. » La clé réside dans la capacité à observer ce qui se passe dans son corps, sans se laisser envahir par une spirale de pensées négatives. Un athlète entraîné mentalement peut ainsi accueillir les signaux de fatigue comme des informations, et non comme des menaces. Cette posture intérieure change tout : elle permet de rester centré sur l’expérience, sur la progression, et même sur le plaisir de relever un défi hors norme.
Il y a aussi les cas de souffrance sans douleur : pas de signaux physiques ou physiologiques, pas de blessure, pas de problèmes digestifs, et pourtant on souffre. Cette souffrance peut être causée par de nombreux signaux extérieurs rendant notre perception de la course négative : un temps de passage non respecté, un concurrent qui nous double, une météo qui crée de la peur, ou les kilomètres restants qui semblent au-delà de ce que nous croyons de nos capacités.
Il y a aussi la perte de sens : « Mais finalement, pourquoi je suis là ? », « Qu’est-ce que je viens chercher sur cette épreuve ? », « De la reconnaissance, et si oui, de qui ? », « Serai-je un meilleur humain si je suis finisher ? » Ce que je croyais être mes raisons profondes, si importantes pour moi, sont-elles réellement les miennes ou ai-je choisi des valeurs insufflées par un contexte social ? Oui, la souffrance touche l’ego et si aujourd’hui il subit une connotation négative, l’ego a aussi son rôle à jouer : celui de la confiance, de la croyance en nos capacités. Il n’est pas nécessairement mal placé. Un ego qui titube de souffrance, c’est aussi un pas de plus vers l’abandon.
Je ne suis pas non plus en train de dire que la souffrance est l’ennemi et la douleur est l’ami. Les deux sont là avec leur rôle : la douleur pour l’intégrité physique, la souffrance pour les contours identitaires.
Les raisons profondes
On ne peut pas prétendre courir 160 km sans souffrance sans être aligné. Même si certains points de mes raisons restent à clarifier, je sais déjà ce que je ne viens pas chercher dans ces épreuves. Assurément pas l’argent — cela me coûte plus que cela ne rapporte. Pas non plus le besoin de publier mon chrono, ma place ou ma performance : je me sens assez détaché du regard social.
Pendant longtemps, j’ai cru que je voulais affirmer une valeur : « je tiens la distance ». Mais cette phrase ne m’est jamais revenue en tête. En revanche, que ce soit pendant la course ou durant la préparation, j’ai assouvi cette envie profonde d’être en montagne. Passer des jours et des nuits là-haut, sous différentes conditions météo, me remplit de joie. Je n’y vais pas pour fuir quelque chose, mais pour être présent, sentir, écouter, observer. Cet exercice d’introspection me conduit à penser que ce que je défends, c’est la liberté. C’est ce que je ressens en montagne, et cela fait sens puisque beaucoup de mes choix de vie sont tournés vers cette valeur.
J’ai l’habitude de dire que la liberté, c’est de choisir ce qui nous en éloigne. Sur cette course, j’ai choisi les contraintes (même si le libre arbitre n’est peut-être qu’une illusion). J’ai couru parce que j’aime être là, parce que je m’y sens bien, libre, sans avoir à me justifier. J’ai accepté de payer la facture : douleur, inconfort, fatigue, incertitude. Et j’étais en accord avec ce choix.
Les outils de préparation mentale
Avoir des raisons profondes est une base solide. Mais cela n’exclut pas les difficultés. Ne pas rencontrer de problèmes n’est pas l’objectif. Ce qui m’intéresse, c’est l’incertitude, et la manière de rester confortable face à elle.
On pourrait croire qu’il faut se préparer à toutes les éventualités et emporter une énorme boîte à outils pour gérer chaque problème. C’est une stratégie valable, car elle augmente la confiance en réduisant l’écart entre nos compétences et celles exigées par le projet. Mais ce type de préparation réduit surtout les risques d’incertitude sans vraiment préparer à y faire face.
L’incertitude, elle, génère des situations imprévues. Et sur ce type de distance, elles sont inévitables. Parfois, elles ne sont pas négatives, mais elles déclenchent une cascade de pensées. Quand elles virent au négatif, il faut agir vite. Pour ma part, j’utilise la vision périphérique, la dissociation, des phrases-parades et la respiration.
En amont de la course, j’ai pratiqué la cohérence cardiaque et la sophrologie pour réguler le stress, évacuer le négatif et maintenir un haut niveau de confiance. Les dernières semaines d’affûtage font souvent surgir de petites douleurs qui minent la confiance et génèrent de l’anxiété. Ces techniques m’ont permis de bien récupérer et de profiter de nuits complètes jusqu’à la dernière.
Courir 160 km sans souffrance ne veut pas dire que je n’ai pas ressenti de douleur, bien au contraire. Chaque pas a été accompagné de sensations physiques parfois intenses. Mais grâce à une préparation mentale solide, j’ai pu transformer cette expérience en un voyage intérieur où la douleur ne s’est jamais convertie en souffrance. Ce qui m’a porté, ce sont mes raisons profondes, mon amour pour la montagne et la liberté que j’y ressens.
Cette aventure m’a confirmé que la performance ne se mesure pas uniquement en temps ou en classement, mais dans la capacité à rester aligné avec soi-même, à traverser les épreuves en conscience et à en sortir grandi. C’est là que réside, à mes yeux, le véritable enjeu de la préparation mentale.
Trouver ses valeurs pour performer donne de la valeur à ses performances.
Et vous, qu’est-ce qui vous porterait à travers 160 km d’effort ?